Combattre les "forces obscures" du naturalisme : les vertus du simulacre pour mettre en scène le pouvoir politique (Ghelderode, Genet et Py)
Résumé
Dans "Le Paradoxe sur le comédien", Diderot résume d'une phrase l'écart ontologique entre l'espace scénique et l'espace public : "Encore une fois, que ce soit un bien ou un mal, le comédien ne dit rien, ne fait rien dans la société précisément comme sur la scène ; c'est un autre monde." Or, la réflexion diderotienne est parfois oubliée aujourd'hui et l'on assiste au retour du théâtre illusionniste, qui se voudrait en prise directe avec le monde et capterait la "parole vive". Plutôt que de céder aux "forces obscures" du naturalisme, selon l'expression du metteur en scène Sylvain Creuzevault, ne pourrait-on saluer les vertus du simulacre ? L’impuissance du théâtre à créer "autre chose que des images" (Michel Corvin) ne sert-elle pas au mieux la représentation d’un pouvoir politique devenu lui-même spectacle ? Michel de Ghelderode, Jean Genet et Olivier Py partagent tous trois un goût pour le grotesque et la bouffonnerie, et refusent un théâtre "prestidigitateur", placé sous la tutelle du réel : il y a moins coupure radicale avec le monde, et son agitation politique en particulier, qu’un rapport distancié et poétique. L’étude comparée de "Pantagleize", du "Balcon" et du "Pain de Roméo" révèle l’exercice à vide d’un pouvoir politique qui "se montre ou se dit" (M. Corvin) plus qu’il n’agit. Ces trois pièces, respectivement parues en 1929, 1956 et 1995, soulignent l’inclination des figures du pouvoir pour le spectacle jusqu'à ce qu’elles se transforment, malgré elles, en figurants. Mais nous voudrions dépasser le simple constat d’une esthétique du trompe-l’œil qui anticiperait le diagnostic d’un Guy Debord sur "La Société du spectacle" (1967) et d’un Philippe Muray sur le "post-réel ". L’effacement de la démarcation entre la scène et le monde réel rend impossible l’épreuve des faits attendue de tout pouvoir politique, telle est la leçon à retenir de "Pantagleize", du "Balcon" ou du "Pain de Roméo". Le règne absolu de l’artifice est d’autant plus intéressant à analyser, d’un point de vue politique, que les trois pièces évoquent un soulèvement révolutionnaire ou une guerre civile qui pourrait le contester : l’action politique violente n’est elle pas elle-même intégrée au spectacle globalisé ? Et, s’il ne s’est rien passé, ou plutôt si rien ne peut plus se passer, le théâtre ne voit-il pas ses pouvoirs renforcer grâce à l’exaltation du simulacre ?
Fichier principal
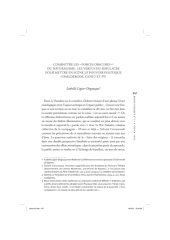 ArtILigierDegauque_RevueRaisonPublique_n°12_2010.pdf (136.14 Ko)
Télécharger le fichier
ArtILigierDegauque_RevueRaisonPublique_n°12_2010.pdf (136.14 Ko)
Télécharger le fichier
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
|---|