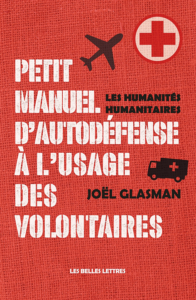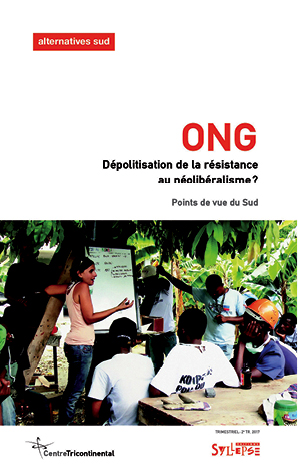
Dossier « ONG. Dépolitisation de la résistance au néolibéralisme ? Points de vue du Sud »,
Revue Alternatives Sud
Centre tricontinental
Louvain-la-Neuve, Belgique
Éditions Syllepse, 2nd semestre 2017
Ce numéro de la revue Alternatives Sud du Centre tricontinental (CETRI) du second semestre 2017 apporte une contribution intéressante au débat au centre des deux derniers numéros d’Alternatives Humanitaires. Les sept articles qui le composent interrogent, en le repolitisant, le débat sur la coopération des ONG avec les acteurs publics et privés (notamment lucratifs). Ils éclairent les causes de la dépolitisation des ONG, les enjeux liés au développement du néolibéralisme qui tendent à réduire le rôle des États et à faire évoluer la culture organisationnelle des ONG (l’instrumentalisation dont les ONG font l’objet, la professionnalisation managériale, ainsi que le paternalisme et la voie « réformatrice » souvent privilégiés) comme l’annonce l’éditorial de Julie Godin.
Dans cette publication se mêlent les analyses de chercheurs et de professionnels du secteur de l’aide. Tous proposent un regard critique pour analyser des phénomènes mondiaux qui touchent l’ensemble du secteur : le risque d’instrumentalisation (chapitre 1 par Thomas Gebauer et Shankar Gopalakrishnan), le paternalisme (chapitre 7 par Léon Koungou). Mais cette critique propose des réflexions sur des zones géographiques telles que l’Amérique latine (chapitre 4 par David Dumoulin Kervran) et en Amérique centrale (chapitre 5 par José Luis Rocha), comme une analyse sectorielle (les ONG environnementales dans le chapitre 8 par Alain Le Sann). D’autres articles sont des études de cas sur des sujets tels que le mouvement indien de femmes (chapitre 2 par Sruka Roy), les ONG palestiniennes (chapitre 3 par Walid Salem), les ONG en Ouganda (chapitre 6 par Maria Nassali).
Dans ce compte-rendu, nous avons choisi de présenter un peu plus en détail deux chapitres : l’un sur la problématique générale de l’instrumentalisation (chapitre 1 par Thomas Gebauer et Shankar Gopalakrishnan), et l’autre sur le cas spécifique des ONG en Ouganda (chapitre 6 de Maria Nassali).
Dans le chapitre 1, Thomas Gebauer et Shankar Gopalakrishnan font un plaidoyer en faveur d’une repolitisation des ONG afin d’éviter le péril de l’instrumentalisation. Ils dénoncent les conséquences des financements institutionnels (vecteurs d’apolitisme), qui impliquent des logiques de contrôle et de performance. Ainsi les ONG auraient tendance à se positionner d’autant plus facilement dans le secteur de l’urgence humanitaire. Ce positionnement ne permet pas de s’attaquer aux causes profondes des inégalités sociales, et ne peut être un véritable vecteur de justice sociale. Au contraire, il favoriserait un statu quo lié à la culture hégémonique néolibérale selon laquelle il existerait « un monde divisé entre les personnes qui apportent leur aide et celles qui la reçoivent, [qui] paraît bien plus acceptable qu’un monde divisé entre personnes privilégiées et personnes sociales exclues ». Il conviendrait donc d’être particulièrement vigilant quant aux collaborations avec les acteurs promoteurs d’intérêts commerciaux (et lucratifs), comme dans le secteur militaire et sécuritaire et les acteurs « philantro-capitalistes », qui sont des agences de légitimation politique. Thomas Gebauer propose donc cinq pistes pour permettre aux ONG de se repolitiser : développer leur esprit critique, prendre des positions politiques, développer leur indépendance, réarticuler leur action avec les mouvements sociaux, et accroître leur mise en réseau en faveur de politiques de changement à plus long terme.
Dans le chapitre 6, l’avocate Maria Nassali présente le cas des associations en Ouganda. Ces organisations sont considérées comme des appendices du gouvernement du fait d’un cadre de plus en plus restrictif (durcissement du cadre légal, érosion de la liberté de réunion), propice aux interférences politiques. À ce panorama s’ajoutent de fortes rivalités quant à la captation des ressources de la coopération, et en matière d’insertion dans des réseaux de pouvoir, afin de pouvoir survivre. Ces dynamiques favorisent largement le retranchement des ONG derrière une attitude « apolitique ». L’autrice esquisse un chemin de sortie en faveur du renforcement d’une conscience politique au sein des associations en promouvant une militance (en faveur de sujets auxquels des droits sont attachés) orientée vers la sphère juridique pour continuer à œuvrer en faveur de la justice sociale. Malgré un cas d’étude soulignant le faible espace d’action lié par un contexte autoritaire et le fonctionnement néolibéral du secteur de la coopération, Maria Nassali parvient à faire une proposition pleine d’espoir.
Ce numéro permet de diffuser en français de nombreux articles parus dans des revues anglophones. Les études proposées interpellent par leur actualité et la finesse de leur propos abordant tout en nuances les problématiques de l’aide. Sans condamner les choix faits par les ONG présentées, elles permettent au contraire de poser des questions centrales pour le secteur. Il s’agit d’analyser les choix des ONG et leurs conséquences, tout en tenant compte des contextes dans lesquels ils s’insèrent. Ces articles montrent bien comment les ONG, face à des enjeux qui les dépassent, sont prises dans des logiques néolibérales. Les auteurs insistent : il n’existe aucune formule magique pour résoudre les problématiques auxquelles font face les ONG. Cependant, ce numéro esquisse de véritables pistes d’action, avec intelligence et tact, pour améliorer les marges de manœuvre dans le secteur, appelant à une nouvelle politisation des acteurs de l’aide.