Aide sociale et obligation alimentaire
Résumé
« Qui doit nourrir, vêtir, loger les pauvres gens sans ressources ? Dans un monde assez christianisé pour ne plus guère trouver convenable que la misère les supprime naturellement, et pas assez déchristianisé pour affirmer qu’il appartient à la société de les supprimer scientifiquement, ils ne peuvent vivre qu’aux dépends d’autrui. Il faut donc leur trouver un débiteur alimentaire. Mais lequel ? Une collectivité ou un individu ? L’Etat, la commune, la profession ou la famille ? » (R. SAVATIER, « Un exemple des métamorphoses du droit civil : l’évolution de l’obligation alimentaire », D. 1950, chr. p. 159 ; Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil aujourd’hui, 1ère série, Panorama des situations, 3ème éd., Dalloz, Paris, 1964, n° 215, p. 259). Afin de secourir les personnes dans le besoin, le Code civil de 1804 avait surtout compté sur la famille, parmi les membres de laquelle il avait désigné des débiteurs alimentaires. Le principe de l’obligation alimentaire, expression de la solidarité familiale, était donc consacré.
La famille n’est cependant pas la seule à assumer une mission de solidarité. En effet, à la solidarité familiale originaire s’est ajoutée la solidarité publique. Pendant des siècles de chrétienté, tout d’abord, l’Eglise, institution de droit public, se trouvait en quelque sorte, juridiquement chargée, grâce aux legs pieux et aux contributions des paroisses, du ministère de charité. La sécularisation progressive de principe d’assistance sociale allait, ensuite, conduire à promouvoir peu à peu l’idée de solidarité collective, laquelle implique que tout Etat doit à ses membres un droit de sécurité matérielle, quand il ne veut pas les laisser périr de faim. L’aide sociale en venait ainsi à recouvrir toutes les formes d’aide que les collectivités attribuent aux personnes qui se trouvent dans une situation de besoin (E. ALFANDARI, Action et aide sociales, Précis Dalloz, 4ème éd., Paris, 1989, n° 1, p. 1). Lors de la mise en place en 1945 du système de Sécurité sociale, la politique traditionnelle d’aide sociale paraissait condamnée à perdre son importance et sa raison d’être. En effet, le nouveau dispositif était destiné à être étendu à la généralité de la population et devait fournir, compte tenu de la situation de plein emploi et de la croissance économique, une sécurité pour tous d’un niveau satisfaisant. Mais, très rapidement, les insuffisances et les limites des techniques assurantielles classiques dans la couverture de la totalité des besoins collectifs allaient confirmer l’aide sociale comme une pièce maîtresse de notre système collectif de protection, aux côtés de la Sécurité sociale.
Il était donc inévitable, dans ce mouvement en avant d’enracinement du principe de solidarité sociale, que le droit de l’aide sociale rencontrât le droit civil de l’obligation alimentaire, puisque l’un et l’autre ont, en somme, la même finalité. Comme le souligne Monsieur Jean PELISSIER, « ce n’est pas l’origine, familiale ou non, qui donne à l’obligation un caractère alimentaire. C’est sa destination. Sont alimentaires toutes les prestations ayant pour but d’assurer à une personne besogneuse des moyens d’existence » (J. PELISSIER, Les obligations alimentaires. Unité ou diversité, Thèse, LGDJ, Paris, 1960, p. 2). L’aide sociale apparaît donc comme l’obligation alimentaire de la collectivité publique.
Le caractère bicéphale du droit aux aliments laisse place à une primauté de l’aide familiale par rapport à l’aide publique. Certes, l’aide sociale constitue une obligation pour la collectivité, et non une simple faculté ; elle est un droit pour la personne dans le besoin, et non une simple faculté. Toutefois ces principes fondamentaux, s’ils ne sont pas nouveaux, n’en sont pas moins affectés aujourd’hui encore, d’une sérieuse limite : l’individu privé de ressources n’est généralement à la charge de la collectivité que pour autant que sa famille ne peut le secourir. En d’autres termes, l’aide sociale apparaît comme subsidiaire par rapport aux obligations alimentaires familiales. C’est pourquoi l’obligation alimentaire familiale réapparaît au sein même du droit de l’aide sociale : cette dernière n’intervient qu’à titre de complément ou à défaut de créances alimentaires.
Les difficultés et le contentieux générés par l’application du principe de subsidiarité de l’aide sociale par rapport à l’obligation alimentaire familiale, en ce qui concerne notamment l’aide sociale aux personnes âgées, invitent aujourd’hui les juristes à mener une réflexion sur les rapports qu’entretiennent, en droit français, l’obligation alimentaire et l’aide sociale, c’est-à-dire sur l’articulation entre solidarité sociale et solidarité familiale. Cette question, qui se situe au cœur des préoccupations sociales et politiques actuelles (v., récemment : C. ATTIAS-DONFUT, « L’Etat, substitut des familles ? », Dr. soc. 1999, p. 481), a pour objet ce qu’il y a de plus fondamental dans une société : le droit de l’individu à la satisfaction de ses besoins vitaux. En effet, par l’intermédiaire du droit, c’est la manière dont la société appréhende le pauvre qui est ici en cause (v. : S. DION-LOYE, « Le pauvre appréhendé par le droit », Rev. rech. juridique 1995-2, p. 433). Le caractère subsidiaire de l’aide sociale vis-à-vis de l’aide familiale doit, par conséquent, faire l’objet d’une réflexion sur l’économie des relations entre public (l’Etat) et privé (la famille) dans la prise en charge du besoin de l’individu. Comme le souligne Monsieur Jacques COMMAILLE, « la question familiale s’élargit en question sociale [qui assure la protection et l’autonomie des individus ?] et en question politique [comment s’établit le rapport de l’individu au collectif ?] » (J. COMMAILLE, Misères de la famille. Question d’Etat, Presses de science po, Paris, 1996, p. 12).
Cette étude propose, dans une première partie, une mise en perspective de l’aide sociale et de l’obligation alimentaire familiale, afin de confronter leur fondement et leur contenu. La seconde partie est, quant à elle, consacrée à la manière dont ces deux obligations alimentaires s’articulent, l’une par rapport à l’autre.
L’aide sociale et l’obligation alimentaire familiale, si elles constituent toutes deux des obligations alimentaires reposant sur l’idée de solidarité, apparaissent totalement autonomes, tant dans leur conception que dans leur régime juridique.
Tout d’abord, les approches du lien de solidarité dans le droit de la famille et le droit de l’aide sociale s’avèrent relativement antagonistes. Le droit de la famille crée un réseau de droits et de devoirs, en s’attachant à suivre la conception qu’il se fait du sentiment de solidarité et de son intensité au sein de la famille. Ainsi peut-on distinguer des obligations alimentaires renforcées, concernant le cercle familial restreint, telle que par exemple l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants, et des obligations alimentaires simples, concernant le cercle élargi. Le droit de l’aide sociale, en revanche, se construit sur la base d’un constat objectif qui résulte de l’interdépendance de fait entre les membres du groupe social. Il élabore une loi de solidarité entre eux et lui donne un contenu concret.
Il en résulte de nombreuses conséquences, quant au régime juridique afférent à l’aide sociale et l’obligation alimentaire. Ainsi la vocation aux aliments, et à travers elle, la détermination des personnes susceptibles de faire valoir l’existence d’un lien de solidarité, est-elle appréhendée différemment en droit civil et en droit social. De même, le besoin, dont la survenance entraîne la transformation de la vocation aux aliments en droit exigible, ne fait-il pas l’objet d’une conception identique en matière d’aide sociale et d’obligation alimentaire. A une conception « relative » du besoin mise en œuvre en droit de la famille, s’oppose une conception « absolue » du besoin en droit de l’aide sociale, ce qui implique que la mesure du besoin, qui permet de déterminer précisément le droit exigible, est établie de manière distincte dans ces domaines respectifs.
L’analyse de ces deux rapports alimentaires, mettant respectivement en scène la collectivité et la famille, montre qu’ils relèvent de sphères répondant à des logiques autonomes. Il existent indépendamment l’un de l’autre, car deux conceptions différentes de l’idée de solidarité sont à l’œuvre.
Il apparaît dès lors difficile de considérer que le lien de solidarité sociale s’inspire du lien de solidarité familiale, tout en étant plus lâche compte tenu de l’étendue du groupe. On ne saurait, par conséquent, invoquer l’existence de « cercles concentriques de solidarité », de plus en plus larges, allant de la famille restreinte à la collectivité publique, en passant par un cercle familial élargi, pour justifier le caractère subsidiaire de l’aide sociale par rapport aux obligations alimentaires familiales.
En dépit des logiques autonomes auxquelles répondent ces deux obligations alimentaires, le caractère subsidiaire de l’intervention de la collectivité publique par rapport à la solidarité familiale constitue un des « principes fondamentaux » de l’aide sociale classique. L’obligation alimentaire familiale se trouve ainsi au cœur de l’aide sociale. La « rencontre » entre ces logiques distinctes apparaît de nature à soulever de nombreuses difficultés, lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre le principe de subsidiarité de l’aide sociale vis-à-vis de l’obligation alimentaire familiale.
L’application de ce principe, en matière d’aide sociale, fait l’objet de deux procédés distincts. C’est ainsi, tout d’abord, que les services de l’aide sociale tiennent compte des créances alimentaires du postulant lors de l’admission à l’aide sociale. La détermination de la part de l’aide familiale revêt alors une importance toute particulière. Pourtant, les commissions d’admission semblent jouir d’une assez grande liberté pour fixer l’étendue de la participation des débiteurs alimentaires afin d’en déduire la part résiduelle des besoins que l’aide sociale devra satisfaire. Il est alors à craindre que ces commissions seront incitées à fixer les dettes alimentaires à un montant élevé, afin de limiter les dépen publiques. Or, c’est théoriquement au juge judiciaire qu’il revient de fixer l’obligation alimentaire, tant dans son principe que dans son étendue, en appliquant le principe de proportionnalité entre les besoins du créancier d’aliments et les ressources du débiteur potentiel. Cette première manifestation du principe de subsidiarité constitue, de ce fait, une source de tensions entre l’aide sociale et l’aide familiale qui relèvent de contentieux et de règles distincts.
Ces difficultés apparaissent dans toute leur plénitude s’agissant des recours ouverts à la collectivité à l’encontre des débiteurs alimentaires. On songe, tout d’abord, aux recours exercés par le Président du Conseil général en matière d’aide sociale, sur le fondement de l’article 145 du Code de la famille et de l’aide sociale. Il s’agit parfois d’un recours dans l’intérêt de l’assisté, qui consiste, pour la collectivité, à secourir les créanciers d’aliments qui n’osent pas ou qui hésitent à poursuivre leurs proches en justice afin de réclamer l’aide laissée à leur charge ; dans cette hypothèse, l’aide sociale ne fait l’avance d’aucune somme. Mais il arrive aussi que la collectivité consente une avance sur créances alimentaires et cherche ensuite à en obtenir récupération auprès des débiteurs d’aliments auxquels la dette aurait dû incomber. Cette action soulève de nombreux problèmes juridiques, qu’il s’agisse du fondement juridique de ce recours ou des conditions de son exercice.
De même, la question se pose de savoir à quoi les débiteurs alimentaires peuvent être tenus, lorsque les établissements publics de santé, ayant pris en charge les frais d’hospitalisation et d’hébergement d’une personne, en demande le remboursement auprès de la famille, sur le fondement de l’article L. 714-38 du Code de la santé publique. L’enjeu tient, ici encore, en l’application ou non du principe de proportionnalité entre les ressources du débiteur d’aliments et les besoins de la personne hospitalisée. On ne s’étonnera donc pas que le contentieux, en la matière, révèle une certaine tension entre les positions de la Cour de cassation et celles du Conseil d’Etat. La pratique administrative d’émission de titres exécutoires, en matière de recouvrement des créances hospitalières et d’aide sociale, a, quant à elle, donné naissance à un véritable conflit de compétences entre les juridictions judiciaires et administratives, lequel se doublait de la question récurrente de l’étendue de la dette des familles. En outre, la question se pose de savoir si cette technique administrative de recouvrement n’est pas illégale.
La complexité et l’abondance du contentieux en la matière s’explique, en réalité, par le fait que le principe de subsidiarité de l’aide sociale par rapport à l’aide familiale n’a pas véritablement fait l’objet d’une justification théorique. Il en découle naturellement de nombreuses incertitudes, dues le plus souvent à l’absence de vision d’ensemble du législateur sur cette question. Pourtant, un mouvement tendant à la suppression de la référence à l’obligation alimentaire semble à l’œuvre depuis quelques années. En effet, le principe de subsidiarité de l’aide sociale par rapport à l’aide familiale a connu, depuis 1975, de nombreuses atteintes, en particulier dans les domaines respectifs de l’aide sociale aux personnes handicapées, de l’aide sociale aux personnes âgées, de l’aide médicale, ou encore du revenu minimum d’insertion (RMI). Ce mouvement constitue l’une des deux facettes de ce que l’on peut nommer une tendance à la « socialisation du droit aux aliments », laquelle se concrétise soit par l’autonomie de la solidarité sociale par rapport à la solidarité familiale, soit par l’adaptation de l’obligation alimentaire familiale aux exigences de la vie sociale.
L’évolution récente du droit de l’aide sociale, notamment sous l’impulsion du RMI, ainsi que les difficultés persistantes résultant de la persistance de la référence aux solidarités familiales pour certaines prestations d’aide sociale, conduit à se demander s’il ne serait pas souhaitable de supprimer le principe de subsidiarité de l’aide sociale par rapport à l’obligation alimentaire familiale.
Cette solution, qui respecterait la lettre même de l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (auquel renvoie la Constitution de 1958, et dont il résulte que « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence », sans qu’il soit question d’une subsidiarité de l’aide sociale par rapport à l’aide familiale), se voit, le plus souvent opposer un argument financier (v., par ex. : J. MASSIP, « Les recours exercés contre les débiteurs d’aliments par les services de l’aide sociale ou les hôpitaux et hospices », Gaz. Pal. 1990, 1er semestre, p. 254). Or, les données statistiques concordent pour montrer que l’impact financier du recours à l’obligation alimentaire est faible, notamment en raison du petit nombre de bénéficiaires qui disposent d’au moins un débiteur d’aliments (v., not., E. SERVERIN, La personne âgée, ses débiteurs d’aliments, et l’aide sociale. Eléments pour une réflexion sur la part de la solidarité familiale dans la prise en charge de l’hébergement des personnes âgées, C.E.R.C.R.I.D., Université de Saint-Etienne, 1990, p. 62, cette étude montrant notamment que dans le département du Rhône, pour l’année 1989, 277 dossiers sur 1490 examinés par les commissions d’admission au titre de l’hébergement des personnes âgées ont comporté une contribution alimentaire, soit 18,5 % des dossiers). En effet, selon le rapport BOULARD, 15 % seulement des 5 milliards récupérés par les départements l’ont été sur les débiteurs d’aliments (Rapport BOULARD, Vivre ensemble, rapport de la commission parlementaire sur la dépendance, A.N., 2ème session ordinaire 1990-1991, n° 2135, p. 30). Le rapport SCHOPFLIN, pour sa part, estime les économies directes qui en résultent pour l’aide sociale à environ 4,7 % des recouvrements opérés au titre de l’aide médicale et à 0,25 % des dépenses brutes d’aide sociale (Rapport SCHOPFLIN, Dépendance et solidarité. Mieux aider les personnes âgées, La documentation française, 1991, p. 97). Dès lors, on peut se demander si le véritable motif justifiant le maintien de l’obligation alimentaire ne tiendrait pas dans son aspect dissuasif sur la demande d’aide sociale (E. SERVERIN, La personne âgée, ses débiteurs d’aliments, et l’aide sociale. Eléments pour une réflexion sur la part de la solidarité familiale dans la prise en charge de l’hébergement des personnes âgées, op. cit., p. 59) ? Cette dissuasion vise celles et ceux qui ont vocation à bénéficier de certaines prestations d’aide sociale. On ne s’étonnera donc pas qu’une enquête sur les personnes de plus de 75 ans en institutions ait montré que la majorité des bénéficiaires de l’aide sociale n’avait pas d’enfant ; parmi les bénéficiaires avec enfants (ceux-ci étant donc susceptibles d’être soumis à l’obligation alimentaire), leurs contacts avec eux étaient faibles, beaucoup plus rares que ceux que les non-ressortissants de l’aide sociale avaient avec leurs enfants (C. ATTIAS-DONFUT, « Dépendance des personnes âgées : pourvoyance familiale et pourvoyance sociale », RFAS 1993, n° 4, pp. 33-51). Cette logique conduit, d’une part, l’Etat, comme l’affirme Madame Claudine ATTIAS-DONFUT, à substituer « sa loi aux choix familiaux, avec le risque de porter atteinte à ce qu’aucune loi ne peut imposer, la qualité des relations » (C. ATTIAS-DONFUT, « L’Etat, substitut des familles ? », Dr. soc. 1999, p. 483). Elle risque, d’autre part, de détruire définitivement les liens familiaux persistants, ce qui semble aller à l’encontre de la logique d’insertion qui traverse aujourd’hui le droit de l’aide sociale.
En réalité, rien ne s’oppose donc à la suppression du principe de subsidiarité dans le droit de l’aide sociale. Certaines expériences étrangères (Suède, Italie…) montrent qu’une telle solution n’est pas irréaliste. Une telle réforme constituerait sans aucun doute une des dimensions de la lutte contre l’exclusion, laquelle est liée à la protection des droits fondamentaux de la personne humaine et au nécessaire respect de l’égale dignité de tous les êtres humains. Ainsi que l’affirme l’article 1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, « la lutte contre les exclusions est un impératif national… et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation ». Sans doute convient-il de tirer progressivement toutes les conséquences de ce principe nouveau. La suppression de la référence à l’obligation alimentaire familiale dans le droit de l’aide sociale constituerait une étape importante. Elle contribuerait, en effet, à redonner à l’idée de solidarité sociale… son sens.
Fichier principal
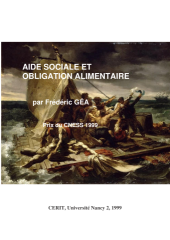 Frédéric Géa - Aide sociale et obligation alimentaire - CERIT, 1999.pdf (1.81 Mo)
Télécharger le fichier
Frédéric Géa - Aide sociale et obligation alimentaire - CERIT, 1999.pdf (1.81 Mo)
Télécharger le fichier
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
|---|